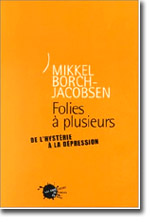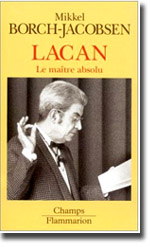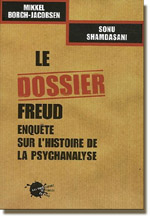|
Usagers de therapies et producteurs
de maladies.
Brèves remarques historico-spéculatives sur l’état
présent du champ ‘psy’.
par Mikkel Borch-Jacobsen |
|
Conférence prononcée le 13 octobre 2006 au colloque La
psychothérapie à l'épreuve de ses usagers. |
|
|
Première
évidence : les associations de patients représentent
l’irruption du politique, sous sa forme démocratique,
dans le champ médical. Jusqu’ici, dans nos sociétés
du moins, le malade était seul face à son mal et aux
divers experts – médecins, apothicaires, thérapeutes
-- qui l’aidaient à le combattre. Ce n’est plus
le cas aujourd’hui. Sous l’influence conjuguée
du consumérisme, du self-help movement anglo-saxon, des formes
d’auto-organisation militante des années 1960-70 et du
networking rendu possible par Internet, de plus en plus de patients
s’organisent en collectifs pour défendre leurs intérêts,
revendiquer leurs droits, faire pression sur les politiques, militer
pour tel traitement ou contre tel médicament. De patients isolés
et passifs, les malades (ou leurs proches, dans le cas de maladies
trop invalidantes) sont devenus des acteurs sociaux à part
entière, qui interviennent dans l’espace public et participent
en tant que citoyens aux débats et controverses qui les concernent.
Seconde évidence : cet activisme
les met inévitablement en tension (ce qui ne veut pas forcément
dire en conflit) avec les professionnels de la santé et les
diverses institutions ou organisations professionnelles qui garantissent
leur expertise. Si les malades s’organisent en collectifs, c’est
bien parce qu’ils ne se satisfont pas, à un titre ou
à un autre, du savoir des spécialistes et entendent
faire valoir leur propre savoir, leur propre expertise de la maladie.
On s’accorde généralement pour faire commencer
l’histoire des associations de patients en 1935, avec la naissance
aux Etats-Unis des Alcooliques Anonymes (Alcoholics Anonymous). Or
les Alcooliques Anonymes, avant de fournir le modèle d’innombrables
“groupes de soutien” et “twelve steps programs”,
se sont d’abord caractérisés par leur refus de
l’approche individualisante et culpabilisante qui leur était
appliquée par les professionnels de la santé: “Nous,
alcooliques, en savons plus, collectivement, sur l’expérience
de l’alcool et sur les moyens d’en sortir que les psychiatres,
psychologues et autres alcoologues. Partageons donc ce savoir entre
nous afin de multiplier nos chances de quitter la bouteille.”
En ce sens, la caractéristique première des collectifs
de patients n’est pas tant l’assistance mutuelle que se
portent leurs membres que la revendication d’une expertise de
la maladie différente de celle des experts et pourtant tout
aussi essentielle, sinon plus, que celle-ci. Une chose est la connaissance
objective, savante, de la maladie, autre chose l’expérience
quotidienne, en première personne, des problèmes qu’elle
pose aux patients et à leur entourage. Si les patients s’organisent
en collectifs, c’est pour faire reconnaître la légitimité
de ce savoir et avoir leur mot à dire dans la gestion de leur
mal, en se posant en interlocuteurs à part entière des
médecins, de l’industrie pharmaceutique et des politiques.
|
télécharger
au format word :


|
|
Cette tension entre l’expertise des patients et celle des experts
se module très différemment selon les maladies en cause
et elle peut aller, comme l’ont montré Michel Callon
et Volona Rabeharisoa, du partenariat à l’opposition[1].
Certains groupes de patients, comme les Alcooliques Anonymes par exemple,
rejettent purement et simplement l’aide des professionnels au
profit d’une autogestion de leur différence, clairement
affirmée et revendiquée. A la limite, cette revendication
identitaire peut aller jusqu’à la remise en cause de
leur statut de malades, comme lorsque les associations gays et leurs
alliés au sein de l’ American Psychiatric Association
ont réussi en 1974 à rayer l’homosexualité
de la nomenclature du DSM-III alors en préparation, en dépit
de l’opposition des psychiatres d’orientation psychanalytique[2].
D’autres groupes, par contre, collaborent étroitement
avec les spécialistes, que ce soit en sponsorisant la recherche
sur leur maladie, comme l’Association française contre
les myopathies (AFM) [3], ou bien en
s’engageant directement, à titre d’“experts-profanes”
(lay-experts), dans les controverses entre experts au sujet des protocoles
d’essais cliniques, comme cela a été le cas avec
les activistes du SIDA aux Etats-Unis [4].
Dans leur très intéressante étude sur les listes
de discussion électroniques entre patients, Madeleine Akrich
et Cécile Méadel racontent comment les animateurs d’une
liste de parkinsonniens ont élaboré, sur la base de
données fournies par les membres du groupe, un logiciel d’aide
à la médication permettant de suivre l’évolution
de la maladie et d’adapter le dosage des médicaments
aux variations individuelles de l’état du malade –
superbe exemple d’expertise “fine” des patients
complétant celle, plus générale, du neurologue
[5].
Pour utiliser une expression anglo-saxonne difficilement traduisible
en français, le regroupement des patients en collectifs a été
pour eux une source d’empowerment: elle leur a donné
le pouvoir d’agir par eux-mêmes sur leur propre condition,
là où ils étaient auparavant impuissants et dépendants
d’ experts et de bureaucrates qui “savaient mieux”.
La forme la plus visible de cet empowerment est bien sûr le
lobbying politique de certaines grandes associations, notamment américaines,
qui rivalisent souvent avec succès avec celui des laboratoires
pharmaceutiques et des organisations professionnelles de médecins.
Mais il y a aussi un aspect thérapeutique à cet empowerment
– du moins est-ce l’une des thèses les plus ardemment
défendues par le self-help movement: être actif vis-à-vis
de sa propre maladie au lieu de la subir passivement est en soi thérapeutique.
Dans une étude fameuse publiée en 1989, le psychiatre
David Spiegel avait cru pouvoir établir que les femmes souffrant
d’un cancer du sein avancé qui participaient à
un groupe de soutien vivaient en moyenne 18 mois de plus que celles
qui n’y participaient pas [6].
Ce chiffre a été contredit depuis par une autre étude
contrôlée [7] qui n’a
trouvé aucune différence entre les deux échantillons
de malades, mais l’idée n’en survit pas moins:
prendre une part active à son propre traitement en en discutant
avec d’autres permet de mieux affronter la maladie. Le groupe,
autrement dit, est thérapeutique.
|
|
|
Enfin, et de façon plus générale, cet empowerment
des malades s’inscrit dans la revendication d’autonomie
et de responsabilité individuelle qui caractérise nos
sociétés libérales avancées. Même
la maladie et la façon de l’affronter sont maintenant
une affaire de choix responsable, de gestion de soi et de calcul des
risques en vue d’une optimisation des résultats. De bénéficiaire
de soins, le malade devient un usager de thérapie, un consommateur
éclairé qui s’informe sur ses options, réclame
la transparence de la part des professionnels et des autorités,
demande à comparer les résultats pour pouvoir décider
librement et en toute connaissance de cause. Les collectifs d’usagers
de thérapie jouent à cet égard un rôle
analogue à celui des organisations de défense des consommateurs,
qui au demeurant mènent souvent des enquêtes de satisfaction
sur les médicaments ou les thérapies (je pense notamment
à l’enquête sur les psychothérapies publiée
en 1995 par Consumer Reports, la grande revue américaine de
défense des consommateurs [8]
). Les experts proposent, les usagers disposent.
Reste que la marge de liberté et de discussion des usagers
dépend des maladies autour desquelles se regroupent les divers
collectifs. Certains traitements sont à l’évidence
moins discutables, disputables, que d’autres. Dans leur article
sur les listes de discussion électroniques de patients, Madeleine
Akrich et Cécile Méadel soulignent que les participants
à la liste sur le cancer qu’elles ont étudiée
ne remettaient à aucun moment en cause les protocoles de traitement
chimiothérapique qui leur étaient proposés par
les oncologues, aussi pénibles fussent-ils, et réagissaient
même avec agacement à toute suggestion de traitement
alternatif [9] . Ceci ne veut pas dire
que la liberté de discussion s’arrêterait ici devant
les hard facts de la science, mais simplement que dans ce cas comme
dans d’autres, il y a consensus entre experts et patients autour
du traitement, qui s’impose comme le seul possible en l’état.
A l’inverse, les médicaments antipsychotiques utilisés
en psychiatrie ont toujours fait débat et controverse , du
fait de leurs effets secondaires extrêmement invalidants. Aux
Etats-Unis, la très puissante National Alliance for the Mentally
Ill, qui regroupe plus de cent mille membres, milite pour que la maladie
mentale soit reconnue comme une maladie biologique comme une autre
et soutient à ce titre les traitements psychopharmacologiques,
combinés à de la psychothérapie de soutien. D’autres
collectifs de patients, qui se qualifient parfois de “survivants
psychiatriques” (psychiatric survivors), rejettent au contraire
avec véhémence le modèle biomédical et
l’usage des psychotropes, qu’ils assimilent à une
toxicomanie forcée [10]. Si
l’on se tourne vers le champ ‘psy’ au sens large,
l’absence de consensus est encore plus marquée, chaque
groupe d’usagers prenant parti pour telle forme de thérapie
contre telle autre. On l’a bien vu lors de la récente
“guerre des psys” en France, durant laquelle les associations
de patients soutenant les thérapies cognitivo-comportementales
se sont violemment heurtées aux usagers de thérapie
analytique réunis dans ces associations de patients d’un
genre un peu particulier que sont les sociétés et écoles
de psychanalyse. Au demeurant, le fait même qu’on ait
pu parler de “guerre” à ce propos montre assez
qu’on est ici dans le domaine de la politique sous sa forme
la plus crue, quels qu’aient pu être les appels des uns
et des autres à la Science-du-Psychisme ou à la Vérité-du-Sujet.
|
|
|
Certaines associations, comme on sait, ont réclamé du
Ministère de la Santé qu’il fasse procéder
à une évaluation comparative rigoureuse des diverses
formes de psychothérapie, afin que la science tranche enfin
dans le dissensus. Décision fort malencontreuse, car cela revenait
de fait à déléguer aux experts la charge d’évaluer
les traitements, alors que cette évaluation, en fin de compte,
est toujours celle des patients, même dans les essais cliniques
les plus “contrôlés”. Ce sont eux, en effet,
qui décident en dernière instance si tel traitement
leur convient en y répondant de façon positive ou négative.
De ce point de vue, les collectifs d’usagers jouent par eux-mêmes
un rôle important d’évaluation, bien plus décisif
et pertinent que celui des experts ès essais cliniques, avec
leur vision étroite de l’efficacité d’un
traitement [11]. Comme le montre
l’attitude des patients atteints de cancer vis-à-vis
des chimiothérapies, un traitement va “tenir” d’autant
mieux qu’il suscite un consensus informé parmi les usagers
et fait taire, serait-ce momentanément, les débats et
les controverses. Inversement, quand le consensus ne se fait pas,
comme cela arrive si souvent dans le champ ‘psy’, c’est
manifestement que le traitement ne convient pas à tout le monde
et que sa généralisation fait problème. Et quand
il y a rejet massif du traitement par les usagers, comme dans le cas
des thérapies d’inspiration analytique imposées
jusqu’à il y a peu aux toxicomanes français, l’affaire
est alors entendue: c’est que les experts ont tort. Comme le
suggère fort justement Tobie Nathan [12],
ce sont les usagers et leurs proches qui sont finalement les véritables
évaluateurs, les vrais “testeurs” de thérapies.
Il n’y a pas meilleur “groupe de contrôle”,
car ils sont le mieux à même de juger de la valeur de
tel ou tel traitement pour eux. Autre façon de dire que les
résultats de la science, aussi bardés de preuves et
de statistiques soient-ils, n’ont de sens que s’ils sont
acceptés par la communauté.
On objectera, bien sûr, que donner le dernier mot aux collectifs
d’usagers équivaudrait à livrer la médecine
à la “mob psychology” et aux charlatans, en jetant
par-dessus bord l’ardu travail de la preuve auquel s’astreignent
les spécialistes dans leurs laboratoires et unités de
recherche. On ne peut pas, disent les défenseurs de l’
“evidence-based medicine”, faire confiance aux patients
pour juger objectivement des traitements qui leur sont appliqués,
car ils ne sont que trop portés à des enthousiasmes
ou à des peurs sans fondement. C’est même là,
comme l’ont montré les historiens des essais cliniques
Harry Marks et Ted Kaptchuk [13],
le point de départ des diverses techniques de contrôle
élaborées depuis la fin du XVIIIe siècle pour
ne pas se laisser tromper par les patients, tels que les protocoles
en aveugle et contre placebo. A cet argument des experts, il convient
de répondre que leur méfiance méthodique à
l’égard des patients est non seulement mal placée,
mais proprement insultante. Elle fait injure à l’intelligence
des patients, car rien n’intéresse plus ces derniers
que de trouver le bon traitement et ils sont tout à fait prêts
à s’incliner devant les “preuves” que leur
fournissent les spécialistes si elles font sens pour eux. Tout
ce qu’ils demandent, c’est à voir par eux-mêmes
et à évaluer les effets des traitements qu’on
leur propose, sans être systématiquement disqualifiés
comme faux témoins de leur propre condition. Si aucun consensus
ne se dégage entre eux, comme c’est le cas aujourd’hui
dans le champ ‘psy’, c’est qu’on est effectivement
dans le domaine des préférences subjectives, chaque
groupe de patients se prononçant pour la thérapie qui
lui convient le mieux. Mais alors il y a peu de chance que la méthodologie
des essais cliniques contrôlés parvienne de toute façon
à créer le consensus manquant. L’histoire récente
des évaluations comparatives des psychothérapies le
prouve assez.
On observera que je n’ai parlé, jusqu’à
présent, que de l’évaluation collective des traitements,
en laissant de côté l’attitude des patients vis-à-vis
de leur maladie. Le fait est que ceux-ci débattent abondamment
des traitements qui leur sont proposés, mais que cette discussion
s’étend rarement à la maladie dont ils souffrent.
Il y a à cela une raison évidente: les collectifs de
patients s’organisent à chaque fois autour d’une
maladie ou d’un trouble particulier qui les définit en
tant que groupe -- association de personnes souffrant du diabète,
de la maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques, etc.
Soumettre ce “donné” premier à débat
reviendrait donc à mettre en question le groupe dans son existence
même. Au demeurant, qui pourrait douter de la terrible réalité
de maladies comme le cancer, les myopathies, la schizophrénie?
Ce serait non seulement absurde, mais particulièrement cruel.
Pourtant, cette évidence de départ se brouille immédiatement
lorsqu’on se tourne vers des troubles comme la fibromyalgie,
le syndrome de fatigue chronique, la dépression, l’anxiété,
la phobie sociale, l’anorexie, la personnalité multiple
ou le stress post-traumatique. Tous ces troubles font débat,
certains arguant qu’il s’agit de maladies psychosomatiques,
ou socialement construites, ou “transitoires” au sens
de Hacking [14],
d’autres qu’ils sont dûs à des déséquilibres
bio-chimiques, à quelque anomalie génétique ou
encore à des traumatismes psychiques réels. Or les collectifs
de patients, dans ces débats, se rangent spontanément
du côté des “réalistes” contre les
“constructivistes” et objectent avec véhémence
à toute relativisation de leurs symptômes, en invoquant
leur expérience vécue de la maladie. Akrich et Méadel
racontent ainsi comment les fibromyalgiques de la liste discussion
électronique qu’elles ont étudiée s’opposent
fermement à toute psychologisation de leur état et marginalisent
très vite ceux qui s’aventurent à la suggérer[15].
Pour eux, même si l’incertitude règne parmi les
spécialistes sur la nature de leur mal, il ne fait aucun doute
qu’il s’agit d’une maladie spécifique, au
même titre que la maladie d’Altzheimer ou le syndrome
de Gilles de la Tourette. Le tout est de trouver le bon médicament,
qui le prouvera une fois pour toutes en stabilisant le diagnostic
de la maladie.
Une telle attitude rend les collectifs de patients particulièrement
perméables à ce que les anglo-saxons appellent le disease
mongering, c’est-à-dire, littéralement, la vente
ou promotion de maladies. Le terme a été forgé
en 1992 par Lynn Payne[16] pour désigner
le marketing de nouvelles maladies par divers groupes d’intérêts
médicaux et pharmaceutiques désireux de créer
une niche commerciale pour l’un de leurs produits. C’est
ainsi qu’ont été récemment lancées
sur le marché, à grand renfort de colloques scientifiques,
de campagnes de presse alarmistes, de statistiques gonflées
et d’essais cliniques soigneusement calibrés, toutes
sortes de “maladies” inédites dont la caractéristique
principale est de répondre, comme par hasard, au traitement
proposé par le laboratoire X ou la molécule brevetée
par le laboratoire Y: la “dysfonction érectile”,
la “dysfonction sexuelle féminine”, la calvitie
masculine, le “syndrome d’irritabilité intestinale”
(irritable bowel syndrome), l’ostéoporose, le trouble
du déficit d’attention avec hyperactivité (attention-deficit/hyperactivity
disorder), et bien d’autres encore [17].
|
|
|
Les responsables de cette incroyable promotion de maladies, qui mobilise
les moyens les plus sophistiqués du marketing et de la communication,
sont le plus souvent les laboratoires pharmaceutiques. David Healy
a montré ainsi comment la firme Merck, au début des
années soixante, a activement démarché le concept
de dépression pour vendre les propriétés antidépressives
de l’amitryptiline [18]. Lilly,
Janssen et Astra-Zeneca, de même, ont promu les troubles bi-polaires
et l’idée de “stabilisateurs de l’humeur”
afin d’étendre le marché de leurs antipsychotiques
olanzapine, risperidone et quetiapine, malgré qu’aucune
étude contrôlée n’ait jamais réussi
à établir leur efficacité et que d’autres
études aient fait apparaître, au contraire, un accroissement
significatif de la mortalité et du risque de suicides [19].
Roche et GlaxoSmithKline, quant à eux, ont lancé sur
le marché la “phobie sociale”, censée être
une bonne indication pour leurs médicaments Aurorix et Paxil
[20] . La revue britannique Pharmaceutical
Marketing, dans son “Guide pratique d’éducation
médicale”, cite d’ailleurs en exemple cette campagne
particulièrement bien menée: “Il arrive même
qu’on ait besoin d’étayer l’existence réelle
d’une maladie et/ou l’intérêt de la traiter.
On en a eu un exemple classique avec le besoin de faire reconnaître
en Europe la phobie sociale comme une entité clinique distincte
et le potentiel d’agents antidépresseurs comme la moclobémide
dans son traitement” [21] .
Le disease-mongering, toutefois, n’est pas propre à l’industrie
pharmaceutiques, car il est tout aussi présent – et ce
depuis bien plus longtemps -- dans le champ ‘psy’. De
même que George Beard, au XIXe siècle, avait lancé
la “neurasthénie” pour créer un marché
pour sa technique électrothérapique et que Freud avait
inventé les “psycho-névroses” pour alimenter
son divan, les thérapeutes cognitivo-comportementalistes, de
nos jours, promeuvent les troubles obsessifs-compulsifs, les troubles
anxieux, le stress et la phobie sociale, toutes pathologies particulièrement
adaptées aux thérapies brèves qu’ils pratiquent.
On pourrait aussi citer le lancement commercial en bonne et due forme
dont a fait l’objet la personnalité multiple de la part
de l’éditeur du livre-culte Sybil au début des
années 70 [22] et l’intense
lobbying psychiatrique qui a abouti dix ans plus tard à l’inclusion
du “Multiple Personality Disorder” dans la nomenclature
du DSM-III [23]. Quant au “syndrome
de stress post-traumatique”, on sait qu’il est pareillement
entré dans le DSM-III au terme d’une véritable
campagne politique menée par les organisations de vétérans
de la guerre du Vietnam et des cliniciens favorables à leur
cause, en dépit du fait que rien ne justifiait de séparer
ce syndrome d’autres diagnostics déjà établis
tels que la dépression, le trouble d’anxiété
générale et le trouble panique [24].
Le syndrome de stress post-traumatique est à présent
au coeur d’une florissante industrie psychothérapique
qui va du “trauma work” à l’EMDR.
Or le fait est que les collectifs de patients, loin d’être
critiques vis-à-vis de cette promotion-production de maladies,
y ont souvent collaboré activement. Tous les laboratoires pharmaceutiques
savent que l’un des moyens les plus efficaces pour lancer un
nouveau médicament est de mettre sur pied une association de
patients et un website idoine. Quoi de plus efficace, en termes de
communication, qu’un groupe de patients réclamant à
cor et à cri qu’on prenne au sérieux leur maladie
et que les tiers payants prennent en charge les frais souvent élevés
de traitement? Sur la brochure d’un séminaire de formation
professionnelle consacré en 1996 à “La création
de campagnes ciblées d’éducation des patients”,
on pouvait lire: “Les campagnes d’éducation des
patients soigneusement planifiées […] deviennent de plus
en plus courantes dans la mesure où les compagnies pharmaceutiques
deviennent conscientes des bénéfices qu’elles
apportent. Durant ce séminaire de deux jours, vous découvrirez
comment créer avec succès des campagnes ciblées
d’éducation des patients qui établiront votre
expertise dans le domaine de certaines maladies et augmenteront le
profil de votre compagnie”. [25]
Moynihan, Heath et Henry, trois auteurs australiens, décrivent
ainsi comment le laboratoire Roche, dans les années 90, a collaboré
étroitement avec une association de patients souffrants de
TOCs et de troubles anxieux, la Obsessive Compulsive et Anxiety Disorders
Foundation of Victoria, pour mettre sur pied un colloque sur la phobie
sociale. Ils rapportent les propos de l’animateur de cette association:
“Roche consacre plein d’argent à la promotion de
la phobie sociale. […] Roche a subventionné le colloque
afin de faire connaître la phobie sociale aux [médecins
généralistes] et aux professionnels de la santé.
[…] C’était aussi un moyen de faire prendre conscience
[de la maladie] aux médias” [26].
La question qui se pose ici, évidemment, est de savoir si la
maladie existait avant que Roche en fasse prendre conscience aux malades…
|
 |
|
La même dynamique est à l’oeuvre du côté
des psychothérapies dynamiques, où l’on voit certains
collectifs de patients militer, très littéralement,
pour la reconnaissance de syndromes lancés sur le marché
par tel ou tel lobby psychothérapique. L’exemple le plus
frappant est sans doute celui de la personnalité multiple dans
l’Amérique des années 1970-80, qui s’est
développée comme un mouvement activiste et prosélyte
sur le modèle des groupes féministes radicaux, à
grand renfort de newsletters de patients, de groupes d’entraide
et de “coming outs” de personnalités en vue dans
les médias. La International Society for the Study of Multiple
Personality and Dissociation, dont les congrès, selon Daniel
C. Dennet et Nicolas Humphrey, ressemblaient étrangement à
des réunions de fidèles [27],
était à la fois une société savante et
une association de patients, au point qu’il était souvent
impossible de distinguer les thérapeutes de leurs clients.
Comme j’ai pu m’en rendre compte lors d’un travail
de terrain mené au début des années 90 dans des
groupes de contrôle de thérapeutes spécialisés
dans la personnalité multiple et l’ “abus rituel
satanique”, ceux-ci se présentaient quasiment toujours
comme des “survivants” d’inceste et d’abus
sexuels et/ou rituels, au même titre que leurs patients. De
même qu’on ne devient psychanalyste qu’après
avoir été soi-même sur le divan, les “experts”
en dissociation étaient eux-mêmes d’anciennes victimes
de traumatisme et militaient avec leurs patients pour la “Cause”,
the Cause, en portant témoignage du mal qui leur avait été
fait à tous.
On voit bien, dans ce cas il est vrai extrême, comment l’expertise
des collectifs de patients, loin de fournir un contre-poids critique
à l’expertise des experts, peut au contraire s’identifier
purement et simplement à celle-ci et amplifier le cercle vicieux
du disease mongering. Ici, pour renverser à peine la formule
de Karl Krauss au sujet de la psychanalyse, la maladie est véritablement
la thérapie qui prétend la guérir, chacune renforçant
l’autre, chacune créant, co-produisant l’autre:
folie à deux, folie à plusieurs.
Qu’en conclure? J’ai commencé cet exposé
avec des évidences, mais arrivé en ce point je n’ai
plus que des questions inconfortables et des pensées mal ruminées.
Je me bornerai à faire quelques remarques, très brèves
et très spéculatives.
|
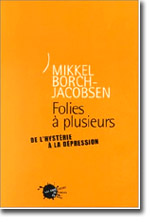 |
|
Remarque no 1 : s’il est vrai
que les collectifs de patients représentent l’irruption
du politique sous sa forme démocratique dans le champ médical,
il ne faut pas s’étonner si cela donne lieu aussi à
des dérapages. La démocratie, comme chacun sait, ne
protège pas contre les errements collectifs et ne fournit aucune
solution toute faite pour y parer, si ce n’est la poursuite
du débat démocratique lui-même. Aux Etats-Unis,
ce ne sont ni les psychiatres-thérapeutes, ni les collectifs
de patients qui ont mis fin à la propagation de la personnalité
multiple et à la chasse aux sorcières auquel donnait
lieu la “recovered memory therapy”, c’est un troisième
acteur politique, la False Memory Foundation créée par
les parents accusés d’inceste et de maltraitance sur
la foi de “souvenirs” retrouvés en thérapie.
Les collectifs d’usagers de thérapie n’ont donc
pas forcément le dernier mot sur leur maladie, car cela se
discute avec d’autres collectifs concernés ou intéressés
par celle-ci. Ainsi, lorsque le laboratoire Pfizer a cherché
à promouvoir la “dysfonction sexuelle féminine”
pour vendre du Viagra aux femmes, ce n’est pas une association
de patients qui lui a fait barrage, mais un groupe de cliniciennes
et d’universitaires féministes, le “Working Group
On A New View Of Women’s Sexual Problems” [28].
Gardons-nous, par conséquent, de tout focaliser sur les rapports
entre collectifs de médecins-thérapeutes et collectifs
d’usagers, car la maladie concerne également d’autres
collectifs, d’autres acteurs qui ont leur mot à dire
|
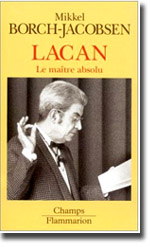 |
|
Remarque no 2 : le disease mongering
affecte le champ médical dans son ensemble, mais c’est
dans le domaine ‘psy’ qu’il est le plus virulent
et qu’il recrute le plus efficacement des malades. La raison
en est que les troubles ‘psys’ ne sont pas des maladies
spécifiques s’incarnant dans une entité discrète
et indépendante des individus qu’elle affecte, comme
dans le cas, disons, de maladies infectieuses ou neurologiques. Quelle
que soit leur nature par ailleurs, les troubles ‘psys’
ne peuvent pas être séparés des patients et de
leur réaction aux diagnostics, aux théories et aux traitements
dont ils sont l’objet, comme il se voit au fait que ces troubles
varient selon les lieux et les époques [29].
On n’est pas “schizophrène” ou “déprimé”
ou “traumatisé” de la même façon ici
ou là, et s’il en va ainsi c’est parce que les
personnes en souffrance interagissent avec les catégories qu’on
leur applique, apprennent à y reconnaître la nature de
leur mal et s’y adaptent en modelant leur comportement et leur
auto-compréhension sur ce qui est attendu d’eux. Les
anthropologues parlent à cet égard d’ “idiome
de détresse” [30], comme
si une quantité x de détresse flottante s’exprimait
en adoptant des idiomes culturels différents selon les endroits.
Ce n’est peut-être pas tout à fait exact, car la
véritable épidémie de “dépressions”
à laquelle nous avons assisté depuis une trentaine d’années
dans le monde occidental montre que nous en sommes arrivés
à un point où c’est la détresse elle-même
qui est fabriquée et vendue avec l’idiome, ici psychopharmacologique,
dans lequel elle est censée s’exprimer. Le disease mongering,
de ce point de vue, n’est jamais que la forme moderne et industrielle
de la co-production des maladies ‘psys’, qu’il se
contente d’amplifier, d’accélérer et de
mondialiser avec le cynisme qui caractérise le capitalisme
libéral avancé. Quant aux collectifs d’usagers
‘psys’, ils rendent pareillement visible la participation
active, si même involontaire, des patients à la fabrication
et à la diffusion de leurs maladies.
|
|
|
Remarque no 3 : Cette participation des
usagers à la construction de leurs propres maladies rend la critique
du disease mongering particulièrement malaisée et peut-être
même sans objet dans le champ ‘psy’. Les intentions
des disease mongerers sont bien évidemment détestables,
mais à quel titre dénoncer la fabrication des maladies
et la manipulation des usagers si ces derniers sont en demande de maladies
pour se fabriquer eux-mêmes, s’ils se construisent une identité
et un soi avec ces médicaments et ces thérapies qu’on
leur propose? Critiquer la fausse conscience et l’aliénation
inhérentes à ce processus supposerait qu’on puisse
leur opposer une vraie conscience, un soi non fabriqué. Mais
c’est précisément ce qui n’est plus possible
dans un monde ‘psy’ où les patients choisissent eux-mêmes
les traitements – c’est-à-dire aussi les maladies
-- qui leur conviennent le mieux et s’organisent en collectifs
autour de ces “formes de vie”, de ces manières d’être
ensemble. Qui sommes-nous pour leur dire qu’ils se trompent? Tout
ce qu’on peut leur proposer, peut-être, est une autre façon
de se construire, une autre façon de se fabriquer en collectif.
C’est-à-dire une autre politique.
|
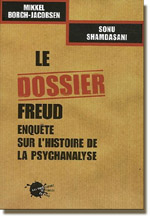
enquête
sur l'histoire de la psychanalyse |
|
Remarque no 4 : J’ignore complètement
ce que pourrait être cette “autre politique”. Peut-être
est-ce un mot creux. Fin des remarques.
|
|
|
|
|
|
|
Notes
[1]. Volona Rabeharisoa
et Michel Callon (avec la collaboration de Michel Demonty), “Les
associations de malades et la recherche. II. Les formes d’engagement
des associations de malades dans la recherche en France”, Médecine
/ Sciences 2000, 16, p. 1225-31.
[2]. Voir Stuart Kirk Et Herb Kutchins,
Aimez-vous le DSM? Le triomphe de la psychiatrie américaine,
Paris, Institut Synthélabo / Les Empêcheurs de penser en
rond, 1998, p. 139-154; Edward Shorter, A History of Psychiatry. From
the Era of the Asylum to the Age of Prozac, New York, John Wiley and
Sons, 1997, p. 303-304.
[3]. Voir Michel Callon et Volona Rabeharisoa,
Le pouvoir des malades, Paris, Presses de l’Ecole nationale des
Mines de Paris, 1999.
[4]. S. Epstein, “The construction
of lay expertise: AIDS activism and the forging of credibility in the
reform of clinical trials”, Science, Technology & Human Values,
4 (1995), p. 408-437; B. Freedman, Suspended Judgment: AIDS and the
Ethics of Clinical Trials, Learning the Right Lessons, Controlled Clinical
Trials, 13 (1992), p. 1-5; K. K.
[5]. Madeleine Akrich et Cécile
Méadel, “Prendre ses médicaments / prendre la parole:
usage des médicaments par les patients dans les listes de discussion
électroniques”, Sciences sociales et santé, 2002,
20, 1, p. 1-22.
[6]. D. Spiegel, J. R. Bloom et E. Gotthell,
“Effects of psychosocial treatment on survival of patients with
metastatic breast cancer”, Lancet, 2 (1989), p. 888-891.
[7]. Gina Kolata, “Cancer study
finds support groups do not extend life”, New York Times, 13 décembre
2001.
[8]. “Mental health: Does therapy
help?”, Consumer Reports, novembre 1995, p. 734-739.
[9]. Akrich et Méadel, art. cit.,
p. 8-10.
[10]. Voir Tanya Luhrmann, Of Two Minds.
The Growing Disorder in American Psychiatry, New York, Knopf, 2000,
chap. 7 et plus particulièrement p. 269.
[11]. Voir Mikkel Borch-Jacobsen, “La
psychothérapie, hier et aujourd’hui”, actes du colloque
“Psychologie, idéologie et philosophie: la psychothérapie
(ou les Psys) en question”, Bruxelles, juin 2006 (à paraître).
[12]. Tobie Nathan, “Pour une
psychothérapie enfin démocratique”, La guerre des
psys. Manifeste pour une psychothérapie démocratique,
Paris, Les Empêcheurs de penser en rond / Le Seuil, 2006, p. 21-27.
[13]. Harry M. Marks, The Progress
of Experiment: Science and Therapeutic Reform in the United States,
1900-1990, Cambridge, Cambridge University Press, 1997; Harry M. Marks,
“Trust and mistrust in the marketplace: statistics and clinical
research, 1945-1960”, History of Science, vol. 38 (2000), p. 344-355;
Ted J. Kaptchuk, “Intentional ignorance: a history of blind assessment
and placebo controls in medicine”, Bulletin of the History of
Medicine, vol. 72 (1998), no. 3, p. 389-433.
[14]. Hacking, Mad Travelers, op. cit.
[15]. Akrich et Méadel, art.
cit., p. 8-10; Shorter.
[16]. Lynn Payne, Disease-Mongers:
How Doctors, Drug Companies, and Insurers Are Making You Feel Sick,
New York, Wiley and Sons, 1992.
[17].Voir Ray Moynihan, Iona Heath,
David Henry, British Medical Journal, 324 (2002), p. 886-891; ainsi
que les articles réunis dans PloS Medicine, 3 (2006): 4.
[18]. David Healy, The Antidepressant
Era, Cambridge, Mass., Harvard University Press., 1998, p. 76.
[19]. David Healy, “The latest
mania: selling bi-polar disorder”, PloS Medicine, 3 (2006): 4.
[20]. Moynihan, Heath et Henry, art.
cit., p. 888; David Healy, “Shaping the intimate: influences on
the experience of everyday nerves”, Social Studies of Science,
34 (2004): 2, p. 222.
[21]. J. Cook, “Practical guide
to medical education”, Pharmaceutical Marketing, 6 (2001), p.
14-22.
[22]. Voir Mikkel Borch-Jacobsen, “Une
boîte noire nommée ‘Sybil’”, Folies à
plusieurs: de l’hystérie à la dépression,
Paris, Les Empêcheurs de penser en rond / Le Seuil, 2002.
[23]. Ian Hacking, Rewriting the Soul.
Multiple Personality and the Sciences of Memory, Princeton, N.J., Princeton
University Press, 1995. p. 51-52.
[24]. Wilbur J. Scott, “PTSD
in DSM-III: a case in the politics of diagnosis and disease”,
Social Problems, 37 (1990), p. 294-310; Allan Young, The Harmony of
Illusions. Inventing Post-Traumatic Stress Disorder, Princeton, N.J.,
Princeton University Press, 1995, p. 108-111; Shorter, A History of
Psychiatry, op. cit., p. 304-305.
[25]. Brochure du séminaire
de formation “Creating Targeted Patient Education Campaigns”,
organisé par l’Institute for International Research à
Londres les 29-30 octobre 1996; cité in Healy, “Shaping
the intimate”, art. cit., p. 226.
[26]. Cité in Moynihan, Heath
et Henry, art. cit., p. 888.
[27]. “Maybe it is not surprising
[…] that at meetings like the one we attended in Chicago [the
Fifth International Conference on Multiple Personality/Dissociative
States, 1988] there is a certain amount of well-meaning exaggeration
and one-upmanship. We were, however, not prepared for what, if it occurred
in a church, would amount to ‘bearing witness’” ,
Nicholas Humphrey et Daniel C. Dennett, “Speaking for ourselves:
an assessment of multiple personality disorder”, Raritan, 9 (1989),
p. 68-98.
[28]. Leonore Tiefer, “Female
sexual dysfunction: a case study of disease mongering and activist resistance”,
PloS Medicine, 3 (2003): 4.
[29]. Edward Shorter, From Paralysis
to Fatigue: A History of Psychosomatic Illness in the Modern Era, New
York, The Free Press, 1992; Ian Hacking, Mad Travelers. Reflections
on the Reality of Transient Mental Illnesses, Charlottesville-London,
University Press of Virginia, 1998; Mikkel Borch-Jacobsen, Folies à
plusieurs. De l’hystérie à la dépression,
Paris, Les empêcheurs de penser en rond/Seuil, 2002.
[30]. Mark Nichter, “Idioms of
distress: alternatives in the expresion of psychosocial distress”,
Culture, Medicine and Psychiatry, 5 (1981), 4, p. 379-408.
|
|
| |
|
 Droits de diffusion et de reproduction réservés ©
2006— Centre Georges Devereux
Droits de diffusion et de reproduction réservés ©
2006— Centre Georges Devereux
|
 |