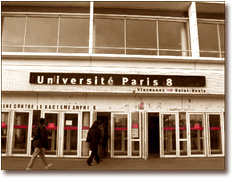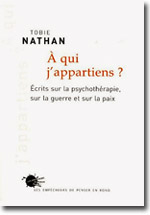CECI
N’EST PAS UNE PSYCHOTHÉRAPIE[1]
par Tobie
Nathan et Emilie
Hermant
|
|
| Université
Paris 8, un peu avant dix heures… |

Tobie
Nathan |
Mise en condition : la ligne 13… Pourquoi
la ligne 13 du métro parisien est-elle aussi inconfortable
? Est-ce seulement parce que les immigrés qui l’empruntent
sont si fatigués qu’ils s’endorment malgré
le vacarme, les arrêts intempestifs, les insupportables mouvements
latéraux des voitures ? Il y fait si chaud l’été,
si froid l’hiver — la ligne 13 est un accélérateur
de température ! Presque à chaque station, monte un
mendiant,
|

Emilie
Hermant |
une mendiante qui n’ont de cesse de
vous rendre coupable — ils crient, pleurent ou chantent ;
en français, rom, en arabe et chacun d’enfouir le nez
dans son journal, de regarder ses pieds, de regarder ailleurs…
La ligne 13 vous donne toujours l’air rêveur. La ligne
13 conduit ailleurs !
Saint-Denis Université ! Vous grimpez
l’escalier… Quelle que soit la saison, un vent violent
vous cueille toujours aux dernières marches. Faux semblants
: les sandwiches ont seulement l’air d’être appétissants
— en vérité, ils sont de fabrication industrielle
— ; les écharpes sont en faux cachemire ; les colliers
fantaisie, les teeshirts sont les mêmes qu’à
République ou à Mairie de Montreuil. On passe son
chemin sans regarder. La ligne 13, il n’y a rien à
voir ! Courants d’air, halls sales, poubelles débordant
d’emballages graisseux, on traverse l’esplanade, tête
baissée, l’attention à peine attirée
par l’odeur des pizzas chaudes et des merguez grillées.
L’entrée principale de l’Université se
trouve face à la sortie du métro. Je n’ai jamais
vu personne traverser au passage pour piétons. Voitures qui
freinent, autobus qui vous éclaboussent, motards rageurs
qui vous font des gestes obscènes… Entrer à
Paris 8 n’est jamais sans risque. La cafète est glacée,
le café a un goût factice, trop sucré ; et sur
les murs, un tapis rougeoyant de propagande à l’aspect
désuet, affiches répétant à l’infini
de marxistes nostalgies… Et puis ces visages de jeunes adultes
cachant leur timidité derrière des masques de sauvagerie
politique.
Bâtiment C, juste en prolongement de « la coupole »,
ce hall froid aux habitudes de cantine d’école communale.
Bâtiment C, immense hangar, bâti comme un hangar, s’inspirant
du dépôt de marchandise ou de la gare de triage, évoquant
d’ailleurs un hangar, un dépôt de marchandise,
le hall d’une gare de triage. L’hiver, il y fait aussi
froid que sur les quais d’un port et les jeunes gens se blottissent
dans les recoins, agglutinés… La jeunesse est toujours
belle…
- Le Centre Georges Devereux ? J’ai déjà entendu
ce nom… Non ! Je ne sais pas où il se trouve. Peut-être
par ici…
Des centaines d’étudiants se pressent vers leur cours
de droit, de cinéma, d’anthropologie, de cinéma…
se pressent vers des lendemains incertains.
- Le Centre Georges Devereux ? Oui ! L’ethnopsychiatrie, bien
sûr ! Paris 8, toujours à la pointe de la recherche
et de l’innovation ! Par ici…
Tout au fond du hangar, derrière un recoin, précisément
là où le mur est défoncé, cicatrice
d’une barre d’acier un jour de manque, une porte toute
simple avec un écriteau…
On entre… Vaste salle, plutôt chaleureuse pour l’endroit.
Une secrétaire derrière son bureau, hôtesse
gracieuse aux grands yeux noirs, vous accueille avec un large sourire.
Deux grands canapés de cuir où patientent une famille
et une équipe de travailleurs sociaux. Pour l’heure,
c’est la cohue. Devant les hôtes assis, les cliniciens,
les stagiaires, les administratifs vont et viennent, se saluent,
s’embrassent, s’interpellent, s’offrent en spectacle,
comme si l’avant-scène jouait le drame à l’envers.
Car pour l’instant, ce sont les patients qui écoutent,
qui regardent, qui observent et imaginent une vie aux thérapeutes…
|
| -
Tu as lu l’article dans Libé ce matin ?
- Jean-Luc, tu ne m’as toujours pas envoyé le compte-rendu
de la dernière consultation…
Les enfants sirotent des jus de fruit, les parents des cafés…
On hésite à débuter, on prend du retard… |
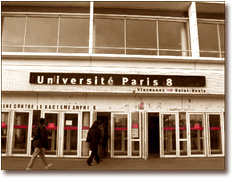 |
| « C’est
fréquent chez nous… » |
Et soudain, tout se calme : la famille et ceux
qui l’accompagnaient ; tous sont entrés dans la grande
salle de consultation et ont pris place au sein d’un large
cercle de chaises occupées par des psychologues, des co-thérapeutes,
des anthropologues, des médecins, des étudiants de
l’Université de Paris 8 en train de parachever leur
formation en psychologie clinique. Si la première fois Amina
et sa famille ont été intimidées par un tel
dispositif, aujourd’hui tout le monde semble à l’aise.
La souffrance n’est pas une affaire privée ; la souffrance
concerne chacun ! La déontologie, ce n’est pas le secret
— la déontologie est avant tout une affaire de tact.
Car dans une consultation d’ethnopsychiatrie, il y a du monde
!
Les situations (ce sont en général des familles),
sont accueillies au sein d’une consultation comprenant un
groupe de professionnels
|
L’ethnopsychiatrie a su
la première — il y a déjà vingt cinq ans de
cela — accueillir la parole spécifique de ces populations
non répertoriées, de ces marginaux sans représentants.
Elle a su ne pas disqualifier leur expérience, y reconnaître
de la force, de la pensée, de la vérité… |
Plusieurs cliniciens — pour
la plupart psychologues, mais aussi psychiatres et anthropologues
; quelquefois d’autres chercheurs dont la réflexion peut
aider à l’élaboration de la situation —
par exemple des philosophes, des sociologues, des chercheurs en médecine
ou en biologie.
Des « experts », les médiateurs ethnocliniciens
connaissant la langue, les objets, les manières de faire du
monde d’où provient la famille.
Le dispositif spatial est circulaire, n’offrant aucun statut
d ’extraterritorialité (pas de bureau, pas de caméra,
de magnétophone ou de glace sans tain…)
Les hypothèses dynamiques, les propositions thérapeutiques
sont immédiatement soumises à la critique, tant du «
patient » qu’à celle des experts ou des chercheurs
présents dans l’espace de consultation, introduisant
le principe d’un débat contradictoire au sein même
de la séance. Car tout est fait pour restituer ici la complexité
du monde :
Les familles sont à la fois des « patients », dont
il convient « d’écouter la souffrance »,
mais aussi des « collaborateurs » dans une démarche
d’investigation, de recherche et de questionnement, tant sur
les maladies que sur les dispositifs thérapeutiques.
Les psychologues sont à la fois des cliniciens diplômés
et des chercheurs soucieux d’éclairer tant les patients
que la communauté sociale du phénomène qu’ils
prennent en charge.
Les experts, médiateurs ethno-cliniciens s’engagent à
mettre leurs connaissances au service du travail thérapeutique.
Quant aux professionnels qui accompagnent les familles — éducateurs
travaillant dans d’autres services, psychiatres responsables
de la prise en charge, psychologues, thérapeutes — ils
participent à l’élaboration générale
de la problématique. On attend d’eux qu’ils évaluent,
critiquent et questionnent le dispositif…
C’est la deuxième fois qu’Amina vient à
la consultation d’ethnopsychiatrie et elle sait que les personnes
qui forment l’assemblée ne sont pas des inquisiteurs
anonymes, des curieux, neutres et malveillants — car la neutralité
du comportement est le travestissement le plus commun de la malveillance
! Elle sait qu’ici, chacun trouve sa place dans le cercle pour
penser, questionner… travail collectif, travail d’équipe
— et Amina fait partie de l’équipe ! — d’un
groupe réuni pour résoudre un même problème.
Mais quel problème ?
Le juge des enfants a adressé Amina et sa famille au Centre
Georges Devereux pour obtenir un « éclairage »,
des « éléments de compréhension »…
Il espère « une intervention à visée thérapeutique
». Il s’attend à ce que l’équipe «
prenne en compte le contexte socio-culturel de la famille ».
Tout le monde le sait : il s’agit d’un problème
public, identifié par un service d’état et la
consultation se déroule en transparence, au vu des personnes
concernées… Impression singulière, comme si, pour
une fois, on nous laissait observer le mécanisme d’une
montre à travers un boîtier transparent. On rappelle
publiquement l’ordonnance du juge ; on assiste aux discussions
techniques des cliniciens, on écoute les remarques des travailleurs
sociaux chargés de la famille. Pas de secret, pas de stratégies
occultes… Pas au sein du dispositif, en tout cas ! La famille
est originaire du Cameroun, plus précisément d’une
région frontalière du Nigéria. Amina est une
jolie jeune fille âgée de 14 ans, grande, timide, déjà
coquette, dissimulant dans la poche d’un grand sweat à
capuche un bras invalide suite à un incident survenu à
sa naissance. On rappelle les événements. Il y a environ
un an, au collège, elle s’est plainte à une amie
du viol qu’elle avait subi quelques mois auparavant. Elle se
trouvait avec ses frères chez une tante paternelle et tout
le monde jouait dans le salon. Un de ses cousins l’a prise à
part dans une chambre et a abusé d’elle. Son amie a prévenu
l’infirmière du collège qui a convoqué
Amina, ses parents, a lancé un signalement au juge des enfants.
Cascade de mesures de protection judiciaire et une année plus
tard, le Centre Georges Devereux est à son tour désigné
pour une consultation — cette fois « d’ethnopsychiatrie
». Le père de famille a disparu voilà bientôt
quatre ans. Sa profession l’impliquait dans un conflit politique,
ethnique, financier aussi, sans doute… Son mari évanoui
dieu sait où pour éviter les geôles de Douala
ou de Yaoundé, la mère d’Amina a subi les interrogatoires
à son tour. Nul ne sait ce qui lui a été réservé…
Les militaires voulaient savoir où se cachait son mari. Réservée…
elle l’est restée, justement ! Elle a finalement décidé
de fuir en France avec ses trois enfants dans l’espoir de bénéficier
du statut de réfugiée politique. Quatre ans plus tard,
la famille est toujours en suspens, sans terre où poser les
pieds, sans point d’appui, sans papier. Et maintenant, les voilà
mêlés à une procédure judiciaire, ouverte
contre l’agresseur d’Amina, qui a probablement pris la
fuite au Cameroun. La mère n’a toujours aucune nouvelle
de son mari. Par dessus le marché, une maladie grave lui a
fait perdre son emploi ; elle ne peut plus payer le loyer du minuscule
studio de 17 mètres carrés. Et ils viennent de recevoir
la notification ; ils seront expulsés dès les premiers
jours du printemps.
|

la station Saint-Denis Université

|

Emilie
Hermant

|
Dans notre salle de consultation, notre agora,
nous discutons… de la politique en Afrique, des rapports du
Nigéria et du Cameroun, du caractère dangereux des
postes de responsabilité dans les pays africains, de l’opposition
entre le Nord, musulman et le Sud, chrétien et encore très
attaché aux traditions animistes…
L’ethnopsychiatrie ? De la psychologie, sans doute, mais qui
refuse de procéder à cette réduction à
l’internalité qui est la forme naïve, primitive
de la discipline. Une pratique thérapeutique, aussi, qui
sait qu’approcher la souffrance des humains telle qu’elle
s’exprime, à la première personne, c’est
aussi de la géopolitique appliquée, de l’anthropologie
du quotidien, du travail social « rapproché »,
de l’action humanitaire sans condescendance…
Et pour que cette discussion soit étayée, qu’elle
rende compte de la polysémie et de l’ambiguïté
du monde, il est indispensable que cohabitent quatre types de personnages
:
- Les professionnels du « psy » (psychologues, psychiatres,
travailleurs sociaux…)
- Les accompagnateurs de la famille, professionnels d’autres
services
- La famille et ses référents (parents, amis, voisins)
- Le médiateur ethnoclinicien
Parmi les participants à cette consultation, se trouve un
« médiateur ethno-clinicien ». Il connaît
les langues parlées dans la région de la famille,
les habitudes régionales, mais aussi la situation politique.
Il en est, il en a lui-même souffert, il raconte, il explique,
il valide. Ce personnage est aujourd’hui comme aux premiers
jours des consultations d’ethnopsychiatrie, la clé
de voûte de toute l’entreprise. Il permet naturellement
de restituer la problématique dans son contexte, dans sa
langue. C’est la moindre des choses, sans doute, mais y avait-il
une place avant ce type de consultation pour la question des coutumes,
cette nature plus forte que la nature, une place pour la langue
? Plus encore, ce personnage est une épreuve pour les thérapeutes,
une contrainte heuristique. Déployer de la psychologie en
sa présence, c’est atteindre à un bonheur de
pensée qui a surmonté les causalités qui s’imposent
d’évidence par leur violence.
Cette fonction née au cours des premières consultations
d’ethnopsychiatrie, il y a plus de vingt-cinq ans à
l'hôpital Avicenne de Bobigny tout d'abord, à la PMI
de Villetaneuse (Seine-Saint-Denis) et enfin au Centre Georges Devereux,
depuis son ouverture en 1993, est celle d’un diplomate engagé
— de ceux qui jouent leur tête à l’annonce
des nouvelles. Au delà de ses connaissances — notamment
linguistiques, ethnologiques, étiologiques, géopolitiques,
le médiateur est avant tout celui qui peut dire, devant cette
assemblée qui s’en étonnera toujours : «
Mais oui, cela est fréquent chez nous[2]
En un mot, le « médiateur » devient l’espace
de la consultation ce qui autorise un « nous » et qui
l’authentifie par sa parole. Il permet de prononcer ce «
nous » sans trahir, sans mépriser, sans critiquer ceux
à quoi ce « nous » se rapporte. Bien plus qu’un
traducteur mis à disposition des thérapeutes, il est
avant tout un principe actif, une sorte de réactif chimique.
Sa présence redistribue les rôles par une sorte de
logique obligée : sa parole transforme le patient en membre
d’un groupe. C’est alors, une fois située, une
fois grandie, nommée — en un mot : aimée —
que la personne en souffrance est susceptible de parler enfin en
son nom.
Car l’ethnopsychiatrie préfère l’intelligence
des patients à leur maladie. On les voit alors démontrer
leur expertise propre, en matière de maladie, de guérison,
d’enjeux sociaux et politiques. On les voit déployer
avec plaisir leur stratégie de vie, s’en amuser…
De malades, ils deviennent vivants, actifs, témoins…
Mais il s’agit bien sûr aussi de traduire. Dans ces
consultations, la traduction ne permet pas seulement de se comprendre
mieux, mais aussi de s’arrêter là où l’on
ne se comprend plus. La parole progresse d’un bord à
l’autre jusqu’à ce que son flux bute sur une
notion. C’est ainsi parce qu’il existe dans chaque univers
des mots, des actes, des choses, des concepts qui ne sauraient être
transposés tels quels d’un monde à l’autre
(Pury, 1998 ; Lutz, 2004). Et l’ethnopsychiatrie c’est
précisément la recherche intéressée
des points d’irréductibilité des mondes. C’est
alors seulement, une fois que l’on en a accepté la
césure, que l’on peut s’engager dans le travail
complexe et souvent risqué consistant à élaborer
malgré tout, les procédures de conciliation et de
négociation entre ces mondes.
On comprend mieux, alors, la nécessité d’une
telle assemblée, intégrant les professionnels, thérapeutes
aux fonctions et aux origines diverses, les patients et leur médiateur,
sans oublier les accompagnateurs de la famille qui représentent
chacun l’un de ces mondes.
Amina redoute les répercussions de son affaire de viol qui
a fait déferler sur la famille déjà si fragile,
opprobre et compassion, suspicion et violence. Tout se passe comme
si on ne lui permettrait jamais d’oublier la souillure qu’elle
a subie. La honte revient, plus douloureuse à chaque fois
qu’elle doit témoigner — devant la brigade des
mineurs, devant ces inspecteurs de police qui semblent se délecter
à l’évocation des détails. Et au delà
de la souillure, dont on devine les conséquences pour cette
famille musulmane originaire d’une région où
l’on pratique la Charia, ce viol a déclenché
une véritable guerre entre la famille paternelle, représentée
par la tante, mère du jeune abuseur d’Amina, et la
petite famille d’Amina, qui habitent toutes deux le même
quartier de Paris.
Au bout du compte, là où l’ordonnance du juge
sollicitait une aide psychologique, certes « culturellement
» éclairée, aujourd’hui, la discussion
conduit les participants à remonter, très en amont,
au moment où les choses ont commencé à se dégrader
entre ces deux familles. Car cette guerre, on s’en rend compte
maintenant, est fort ancienne en vérité. Seulement
ravivée par le viol, elle puise ses origines à la
génération des grands parents. Les deux grands-pères,
tous deux marabouts et concurrents, se sont autrefois brouillés
pour une affaire d’honneur jamais résolue. Le grand-père
paternel était opposé au mariage de son fils avec
la mère d’Amina, si farouchement opposé qu’il
serait même allé jusqu’à menacer «
d’acheter » la descendance que cette union pourrait
occasionner. Les parents, amoureux et obstinés, se sont tout
de même mariés. Aujourd’hui, tout le monde se
rappelle les paroles du grand père, et surtout, leurs conséquences
: si les enfants ont bel et bien été « achetés
», autant dire qu’il sont devenus les esclaves du vieux
marabout, subissant ses ordres par delà les mers ; souffrant
des désordres sans fin qui peut-être en découlent.
Qui connaît la force réelle des malédictions
?
Ainsi, ce qui était haine à la première génération,
se transforme-t-il en amour à la seconde et en sucession
de malheurs à la troisième… D’une banale
affaire de mœurs, nous voilà propulsés au sein
d’une tragédie antique
L’ethnopsychiatrie vient donc s’inscrire dans une réflexion
géopolitique élargie. Voilà les migrants si
loin de leur point de départ et si près de leurs sources.
Nous avons été les premiers à décrire
une nouvelle forme d’allégeance que l’on pourrait
appeler « de longue distance » ; celle de cette diaspora
partie si loin que l’obéissance est devenue interne,
contraignante — pour tout dire : compulsive… Les migrants,
si loin de chez eux, que l’on se plaît à décrire
déliés, et pourtant incapables de s’affranchir
des malédictions que leurs sens ignorent désormais.
L’ethnopsychiatrie a su la première — il y a
déjà vingt cinq ans de cela — accueillir la
parole spécifique de ces populations non répertoriées,
de ces marginaux sans représentants. Elle a su ne pas disqualifier
leur expérience, y reconnaître de la force, de la pensée,
de la vérité…
|
| Dépsychologiser
la psychologie |
À côté,
une seconde salle, beaucoup plus petite, où a commencé
depuis plus d’une heure une autre consultation d’ethnopsychiatrie,
semblable et pourtant bien différente. Entrons ! Ici, l’entretien
réunit moins de monde : deux psychologues et une assistante
sociale écoutent un homme seul, René, qui parle en s’essoufflant,
comme s’il étouffait sous le poids de ses problèmes.
René est reçu au Centre Georges Devereux dans le cadre
d’un dispositif d’aide à l’insertion professionnelle[3]
On y adresse des personnes arrêtées dans leur vie professionnelle,
suspendues — qui ne l’ont jamais commencée, parfois.
Les difficultés sociales liées au manque d’emploi
en France, mais aussi aux ruptures professionnelles des trente dernières
années se sont accompagnées d’une recrudescence
de mesures sociales destinées à venir en aide aux personnes
les plus démunies. Le service qui nous adresse René
met en œuvre l’un de ces multiples dispositifs où
il s’agit d’accompagner les personnes dans leur parcours
vers l’emploi, coûte que coûte, les incitant quelquefois
à entamer une véritable reconversion. Alors qu’elles
se trouvent parfois au chômage depuis de nombreuses années,
il leur propose des bilans, des formations, un accompagnement social,
des aides visant à pallier le manque de revenu, et parfois,
pour celles qui ont connu la déchéance, on tente l’impossible
: reconstruire du sens, tenter de percer les motifs de la chute. Comme
les juges, les travailleurs sociaux demandent à comprendre
pour mieux intervenir, pour mieux aider une population qui, la plupart
du temps ne demande pas de psychothérapie.
René : Le problème, c’est qu’ils essayent
de me contacter, mais moi je ne veux pas. Ca me fait peur… En
même temps, quand vous dîtes qu’on pourrait essayer
de les enlever, je ne sais pas si je suis prêt… Parce
que ça m’intéresse aussi, vous comprenez ?
|
| « C’était
fréquent chez nous » |
De quoi parle ce chef de famille, au chômage
depuis de longues années, vivant à l’hôtel
social avec sa femme et ses deux enfants et souffrant de graves
problèmes de santé. Lui qui, pour tout ce qui concerne
la vie concrète, ne sait joindre les deux bouts, qu’est-ce
donc qui, dans le même mouvement, lui fait si peur et l’intéresse
tout autant ? Ce sont les morts ! Enfant, son père lui avait
appris, en même temps que l’ébénisterie,
le métier de croque-mort. « C’était fréquent
chez nous », nous avoue-t-il, habitude de petits villages
du centre de la France où il n’y avait guère
le choix. C’était au menuisier qui fabriquait le cercueil
qu’il revenait aussi de préparer le mort. Il fallait,
nous raconte-t-il, le laver, l’habiller, le coiffer et le
maquiller… René a longtemps été responsable
de la dernière image que le défunt laissait en souvenir
à ses survivants. Jusqu’à ce qu’il craque…
Précisément le jour où il devait « préparer
» une petite fille. C’est alors qu’il a refusé
d’y toucher… « c’était un ange, nous
avoue-t-il… Non, moi je ne pouvais rien faire… Je me
suis détourné… je ne l’ai jamais plus
fait depuis…». Et c’est après cela qu’ils
sont venus ; comme si une digue s’était rompue ! Une
simple sensation au début, peu intrusive, une sorte de présence
implicite. Et puis, ils se sont manifestés avec plus d’insistance,
revenant se présenter à des moments inattendus, forçant
la place, tenaces… Dans les rêves, bien sûr, mais
aussi dans des images, dans des signes qu’il doit aujourd’hui
décoder sans cesse — grincements de meubles, objets
qui se déplacent selon leur propre volonté, lumières
qui s’éteignent et se rallument inopinément…
Mais ce qui gène surtout René, ce sont les mauvaises
« relations » qu’il entretient avec ses parents,
pourtant décédés depuis de nombreuses années.
Dans ses rêves, sa mère lui adresse des messages qui
lui rappellent qu’il doit « entrer en contact »
avec son père, que bien des affaires sont restées
en souffrance entre eux… puisqu’ils étaient fâchés
au moment de sa mort.
|
|
| « Pour qu’on
me prenne pour un taré, non merci ! » |
| Car telle est l’éthique
de l’ethnopsychiatrie : ne pas hésiter à penser les
personnes attachées à des langues, à des idéologies,
à des lieux, à des groupes, à des forces, à
des choses |
Avant ces consultations,
René n’avait jamais parlé de tout cela avec
quiconque, encore moins avec des psychologues… (« pour
qu’on me prenne pour un taré, non merci ! »).
Les migrants ont appris à l’équipe du Centre
Georges Devereux à travailler avec eux en rendant caduque
le grand partage ; celui qui prétend distinguer « ceux
qui croient » de « ceux qui savent »…, en
rompant avec une tradition qui, en matière de santé
mentale, a hiérarchisé les savoirs, plaçant
d’un côté les « savants », et de
l’autre « tout le reste », fourrant dans le même
sac « croyances et représentations traditionnelles
». L’ethnopsychiatrie a su décrire derrière
ces pratiques des théorisations et des techniques. Elle a
su aimer leur intelligence et souvent constater leur efficacité.
Elle a surtout su apprendre d’elles. Ce sont les leçons
de la clinique des migrants qui ont enseigné à cette
équipe que les « autres », « nous »,
« les Français », appartiennent tout autant à
des groupes traversés par des forces sociales. Là
aussi, ces forces sociales se manifestent sous la forme d’intenses
relations avec des non-humains, avec des « choses »
(Nathan, 2001 a).
Car telle est l’éthique de l’ethnopsychiatrie
: ne pas hésiter à penser les personnes, non seulement
en tant qu’individus singuliers, tributaires de leur histoire,
de leurs cicatrices et des solutions défensives adoptées
au décours de leur existence, mais aussi comme attachées
— attachées à des langues, à des idéologies,
à des lieux, à des groupes, à des forces, à
des choses — même s ’il leur est arrivé
de se révolter contre les forces, de se démarquer
de leurs proches, de se séparer de leur famille ou de se
détacher de leur religion…
Il nous faut penser que René entretient une relation avec
des morts puisque c’est très précisément
son énoncé ! La gageure consiste à accepter
cet énoncé ; à l’acceuillir sans réserve,
comme une prémisse intangible. C’est à nous
de créer une théorie permettant d’enrichir le
monde sans jamais revenir sur la véracité de cet énoncé
initial[4] ! Il nous le dit, timidement,
avec constance, sans folie, sans orgueil… « Parlez moi
des morts, de la relation que l’on peut avoir avec eux ; parlez
moi des objets et non pas des hommes ! De ces objets qui se déplacent
tout seuls, de ces lumières qui s’éteignent
et qui s’allument, racontez moi votre intérêt
pour la vie des choses et je retrouverai ma confiance dans le monde
»…
Ce constat, ne nous jette pas pour autant à côté
de la plaque de la modernité, bien au contraire (Latour,
1991) ! Les cliniciens du Centre Georges Devereux ont progressivement
appris que les forces qui animent les personnes ne peuvent être
envisagées que de manière spécifique. Elles
les contraignent de l’extérieur — non pas de
l’intérieur, comme leurs études de psychologie
leur avaient laissé croire. Autrement dit : René ne
croit pas qu’il a une relation avec les morts ; il a une relation
avec les morts ! Charge nous revient de construire la théorie
qui rend compte du fait. Ce retour aux énoncés sur
les choses et sur les êtres, c’est précisément
ce que Bruno Latour a décrit comme un processus de «
dépsychologisation » à l’œuvre dans
le dispositif ethnopsychiatrique (Latour, 1996) …
Des choses et des êtres, la puissance de forces qui animent,
déstabilisent, agressent et corrigent… Un univers tendu,
aigu, parsemé d’objets intelligents… Tel est
le monde décrit par l’ethnopsychiatrie. Sans oublier
les fonctions qui viennent y prendre place… Les patients sont
animés par les êtres, mais les professionnels tout
autant. Et nous avons appris l’importance de personnages,
à la fois agents et agis, les travailleurs sociaux, à
mi-chemin, médiateurs, représentants du monde complexe
de l’action sociale…
L’ethnopsychiatrie se meut dans ce monde dont elle accepte
la richesse ambiguë, angoissante ; elle le sait multiple, complexe
et dangereux. Dans sa construction du savoir, elle s’allie
avec les patients comme avec des experts, des volontaires et des
témoins…
Des témoins…
|
| «
Je veux aider les autres »… |
Jeanne : Tout
a commencé quelques mois après que j’ai pris
ma retraite. J’avais toujours un peu entassé les journaux
et les articles qui m’intéressaient, mais là,
c’est devenu pire, vraiment pire ! Non seulement je gardais
tout, mais en plus je photocopiais des tas de pages, sur n’importe
quel sujet… Et la nuit, de plus en plus souvent, je me suis
levée, réveillée par une angoisse terrible,
insupportable, avec cette question : « où donc ai-je
bien pu lire cela ? » Et « cela », ça pouvait
être n’importe quoi, une recette de cuisine, quelque
chose sur le réchauffement de la planète, la viste
du Président, que sais-je encore… D’abord c’était
seulement la nuit, et puis ça m’a prise la journée
aussi, pendant des heures. Au commencement, mon mari n’en
savait rien, mais pour moi, ça prenait des proportions…
Et puis, c’est en lisant des articles sur la question que
j’ai compris que je souffrais d’un TOC.
Pour moi, je pense qu’il n’y a plus grand chose à
faire, mais si je viens parler avec vous, c’est pour aider
les autres. C’est aussi pour ça que j’ai adhéré
à l’AFTOC.
Commence alors un entretien en présence
de deux psychologues et d’une anthropologue. La patiente est
seule, sans accompagnateur. Mais en réalité, elle
est un groupe à elle toute seule. Représentante de
l’AFTOC, Association Française de personnes souffrant
de Troubles Obsessionnels et Compulsifs. Elle s’est portée
volontaire pour participer à une expérience qui a
commencé il y a quelques mois au Centre Georges Devereux.
Il s’agit d’inviter des personnes souffrant de TOC à
témoigner de leur maladie, à évoquer les prises
en charge dont elles ont bénéficié, à
dérouler leur compréhension de leurs troubles. Et
cette entreprise se déroule en présence de professionnels
qui disent à leur tour ce qu’ils comprennent, ce qu’ils
savent… L’objectif final est d’élaborer,
avec les patients volontaires, des énoncés qui parviennent
à mettre d’accord l’ensemble des participants.
Il s’agit de parvenir à mener une concertation dont
l’objet est une maladie encore très énigmatique,
à découvrir un être nouveau qui se manifeste
à travers cette maladie, cet être qui afflige les humains,
à décrire son écologie. Comment a-t-on pu durant
si longtemps se passer du point de vue des patients ? Maintenant
qu’ils sont regroupés en association [5]
, les voilà qui apparaissent comme la force sociale essentielle
susceptible d’identifier l’être qui les fait souffrir,
cette entité désormais désignée en français
par le subtil vocable « TOC ». La psychologie clinique
a-t-elle vraiment quelque chose à dire sur les TOC ? Quelque
chose d’intéressant, dans le sens où son apport
ne viserait pas uniquement leur description — encore moins
leur interprétation comme ils en ont fait maintes fois l’objet
par la psychanalyse — une interprétation visant toujours
à disqualifier la perception des patients… Nous avons
constaté à plusieurs reprises par le passé
combien l’alliance sincère avec les patients permettait
un réel impact sur l’évolution de la maladie[6]?
Le but d’un tel travail est d’abord, bien sûr,
de se donner les moyens d’obtenir une réelle phénoménologie,
la plus fine possible, d’une maladie dont les manifestations
diffèrent tant d’un individu à l’autre.
Mais l’intérêt général de cette
phase d’étude microscopique est de parvenir à
articuler ces témoignages avec une autre forme d’énonciation,
à caractère à la fois public et pour tout dire
politique… Les nouveaux énoncés sur la maladie,
tels qu’ils ont de plus en plus tendance à apparaître
sur la scène sociale, générés par les
groupes de patients comme l’AFTOC, seront à la source,
nous le savons de nouvelles pratiques thérapeutiques, plus
compréhensives, plus efficaces, mais aussi plus démocratiques…
Ces démarches, d’un type nouveau, reposent sur trois
séries de faits, nouveaux eux aussi :
- Le regroupement des malades en associations faisant d’eux
une véritable force sociale.
- La diffusion des connaissances — notamment via internet
— rendant les malades aussi savants que leurs thérapeutes.
- Le besoin de témoigner, de « donner », de permettre
aux autres malades de bénéficier de son expérience.
Et ces témoignages des malades seront lus, écoutés,
commentés, non seulement par le grand public qui, on le sait,
en est friand à juste titre, mais aussi par les chercheurs,
les thérapeutes, les laboratoires pharmaceutiques et influeront
de manière décisive sur les orientations de politique
sanitaire émanant de l’Etat.
|
| L’ethnopsychiatrie
|
L’ethnopsychiatrie
est donc une psychothérapie qui tient compte du monde comme il
va : un monde ouvert, cosmopolite, riche d’êtres et de choses.
Elle intègre dans son espace de consultation les familles et
les experts. Elle entend transformer cet espace en un lieu de débat
contradictoire. |
|
Elle entend tenir compte de la situation réelle
de personnes partageant une modernité complexe où
- les associations de malades
créent de véritables groupes d’intérêt
qui s’expriment, cherchent, influent, débattent, remettent
en question
- où un malade n’est pas seulement un être en souffrance,
mais aussi un acteur de la vie sociale qui entend témoigner,
partager son expérience, en tirer éventuellement bénéfice…
Le village planétaire fonctionne alors comme un village d’Europe,
d’Afrique ou d’Asie, où l’efficacité
des thérapies a toujours été évaluée
par ses usagers…
Ainsi, la boucle est-elle bouclée. L’ethnopsychiatrie
a été une psychanalyse restée un temps en sidération
devant la clinique des migrants, mais qui a tiré les leçons
de cette pratique. Elle parvient aujourd’hui à des propositions
pour une psychopathologie générale où les êtres
et les choses reprennent la place qu’ils n’auraient jamais
dû quitter ; où les groupes qui se structurent autour
de ces êtres que sont les maladies deviennent de véritables
interlocuteurs ; où l’on tient compte des forces qui
traversent le monde réel.
Les maîtres-mots ont aussi changé. Pour décrire
le travail de cliniciens, on y parle de « concertation »,
de « conciliation », de « négociation »
et de « diplomatie ». Sa philosophie aussi est tout autre.
L'ethnopsychiatrie est bien plus une méthode, une éthique
qu'une discipline. Elle voudrait faire de l'incertitude une vertu,
du dialogue et de l'hésitation une morale et de la conversation,
la source de la connaissance.
|
| |
|
|
Notes
[1].
premier chapitre de À qui j'appartiens de Tobie Nathan
— texte écrit avec Emilie Hermant, psychologue clinicienne,
coordinatrice du Centre Georges Devereux, Université Paris 8.
[2].
Nathan (2001 d), où j’aborde une longue discussion de cette
remarque typique du médiateur : « cela est fréquent
chez nous »…
[3].La
plupart du temps, cependant, les cliniciens du Centre Georges Devereux
participant à ce dispositif se déplacent au sein de la
structure de réinsertion professionnelle, organisant les consultations
là où les personnes se rendent spontanément pour
tenter de résoudre socialement leurs problèmes. Ce travail
a été décrit de manière très approfondie
par E. Hermant (2004).
[4].
L’un de nous a poussé ce pari aussi loin qu’il savait
le faire, précisément au sujet de la relation avec les
morts : Dagognet et Nathan
(2003).
[5].
Cette recherche est menée en collaboration avec l’AFTOC,
association à laquelle le centre Georges Devereux communique
régulièrement les résultats de son travail.
[6].Ce type de questionnement a été
plusieurs fois éprouvé au Centre Georges Devereux, notamment
à l’occasion de recherches sur la boulimie et l’obésité
(Perrotin, Adrey 2002) et sur les transsexuels (Swertwaegher 1999).
|
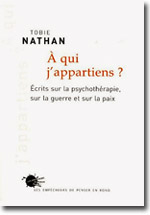
Tobie Nathan : À
qui j'appartiens? Écrits sur la psychothérapie, sur la guerre
et sur la paix. Paris, Le Seuil — les empêcheurs de penser
en rond, 2007. |
| Si vous souhaitez
écrire aux auteurs : Tobie
Nathan , Emilie
Hermant |
|
 Droits de diffusion et de reproduction réservés ©
2007, Centre Georges Devereux
Droits de diffusion et de reproduction réservés ©
2007, Centre Georges Devereux |
 |